Blog du libraire
L’attribution du Prix Nobel de littérature à Jean-Marie Gustave Le Clezio est saluée légitimement par tous ceux qui aiment l’homme, son oeuvre, et la langue dans laquelle il écrit. Vingt-trois ans après Claude Simon, c’est en effet un écrivain français qui est couronné. Français ? Sans doute. Mais certainement beaucoup plus, à nos yeux. Tout, ou presque, a été dit par les critiques littéraires et les journalistes qui le connaissent et l’ont lu, et nous n’avons pas la prétention d’y revenir ici. Une chose pourtant nous paraît essentielle. Le Clezio n’appartient pas à la littérature française en tant que littérature nationale. Son parcours et ses livres en témoignent.
 Fils d’un anglais d’origine bretonne longtemps médecin au Nigeria (voir son magnifique livre L’Africain), petit-fils de mauricien dont il revendique la proximité (Le chercheur d’or, Voyage à Rodrigues…), il n’a cessé de chercher l’ailleurs et d’y trouver la substance d’une bonne partie de son oeuvre. Installé quelques années à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, il a côtoyé les peuples amérindiens d’Amérique centrale (Haï, Les prophéties de Chilam Balam, Le rêve mexicain…). Comme il s’est tourné vers ceux que l’Occident a relégué dans ses marges, mais qui ne cessent de dire leur présence (Désert, Onitsh, Poisson d’or…), et en ce sens il a intégré la littérature de l’après-colonialisme. Le Clezio incarne à merveille l’apport des voix venues d’ailleurs dans la littérature française, et qui en sont un des ferments actuels les plus riches. Comme d’autres, il a rejoint les écrivains du Sud, les haïtiens, les africains, les maghrébins, les libanais, et tous ceux qui représentent l’universalité dont la langue française est porteuse, une ouverture au monde où l’on reçoit autant que l’on donne.
Fils d’un anglais d’origine bretonne longtemps médecin au Nigeria (voir son magnifique livre L’Africain), petit-fils de mauricien dont il revendique la proximité (Le chercheur d’or, Voyage à Rodrigues…), il n’a cessé de chercher l’ailleurs et d’y trouver la substance d’une bonne partie de son oeuvre. Installé quelques années à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, il a côtoyé les peuples amérindiens d’Amérique centrale (Haï, Les prophéties de Chilam Balam, Le rêve mexicain…). Comme il s’est tourné vers ceux que l’Occident a relégué dans ses marges, mais qui ne cessent de dire leur présence (Désert, Onitsh, Poisson d’or…), et en ce sens il a intégré la littérature de l’après-colonialisme. Le Clezio incarne à merveille l’apport des voix venues d’ailleurs dans la littérature française, et qui en sont un des ferments actuels les plus riches. Comme d’autres, il a rejoint les écrivains du Sud, les haïtiens, les africains, les maghrébins, les libanais, et tous ceux qui représentent l’universalité dont la langue française est porteuse, une ouverture au monde où l’on reçoit autant que l’on donne.
La culture française est une culture de métissage. La langue française a reçu des apports de tous les coins du monde, et ça continue. Ce qui est merveilleux avec la culture française, c’est qu’elle est un lieu de rencontres.
Le clezio, un Nobel français, ou un Nobel à la Francophonie ?
J.M.G Le Clezio fait partie du jury du Prix des cinq Continents de la Francophonie, qui vient de couronner le livre de Hubert Haddad, Palestine, paru aux Editions Zulma.
Alors que s’annoncent en librairie les 650 titres de la rentrée littéraire de septembre, un rapide regard, déjà rétrospectif, sur le premier semestre de l’année nous a semblé intéressant. Les meilleures ventes recensées dans les journaux et magazines ont la fâcheuse tendance à se ressembler, et il n’y a pas de raison qu’elles soient absentes des meilleures ventes de Graffiti. Mais comme il se doit en littérature, c’est entre les lignes qu’il faut saisir le sens du texte. Et c’est à ce bref exercice que nous nous sommes livrés.
Premier constat, qui ne surprendra pas : la trilogie Millenium publiée chez Actes Sud fait un tabac. L’éditeur en est heureux, c’est sûr, mais il doit déjà s’interroger sur la façon dont il pourra renouveler cette opération qui tient quand-même du jackpot. On sait qu’un succès génère facilement un « filon », et la présence dans notre liste de La Princesse des glaces, même collection, même format, même origine (suédoise), en est la manifestation évidente. Le livre est excellent, certes, mais on connaît l’effet d’entraînement d’un succès chez le lecteur, friand de valeurs sûres, et les éditeurs savent y faire…
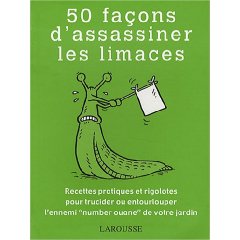
Deuxième constat : Actes Sud est un sacré éditeur, le mieux représenté dans nos meilleures ventes. Il est vrai qu’avec De Lillo, Hustvedt, Bauchau, Banks…, la qualité est assurée, et les lecteurs ne s’y trompent pas. C’est d’ailleurs un des enseignements de l’analyse de nos meilleures ventes, et notre troisième constat : en dehors des best-sellers assurés, les Lévy, Musso, Gavalda, Vargas, Pancol, voire Hosseini, et quelle que soit la qualité de leurs ouvrages, les très bons livres échappent rarement à la vigilance des lecteurs et des libraires. La route, le chef d’oeuvre de l’américain McCarthy, Les Déferlantes de la française Gallay, L’enlacement, du belge Emmanuel, La maison de la mosquée, de l’irano-néerlandais Abdolah, Le village de l’allemand, de l’algérien Sansal, témoignent de la perspicacité et de l’éclectisme des amateurs de littérature. C’est là aussi que le libraire a sa place : nouveau constat, qui nous fait plaisir, on s’en doute. Ces livres ont été lus, appréciés, et donc vendus. Comme l’ont été Les sabliers du temps, pourtant paru en 2006, mais sorti de l’oubli par une de nos libraires sur les conseils d’une cliente, ou Mathématiques congolaises, qui parle de cette Afrique que nous aimons particulièrement. C’est le cas aussi des auteurs que nous avons invités, tant en littérature (Jean-Luc Outers et Le voyage de Luca, Martine Cadière et La dernière danse de Joséphine) que dans le domaine de l’essai (Jean-Paul Marthoz et La liberté, sinon rien. Mes Amériques, de Bastogne à Bagdad).
Et soudain, parmi tous ces titres, un intrus, 50 façons d’assassiner les limaces, succès dû sans doute au fait d’avoir été exposé sur le comptoir, mais plus sûrement encore au problème réel que ces charmantes bêtes posent à nos concitoyens. Des deux côtés de la frontière linguistique dont elles se moquent éperdument, les limaces nous ramènent aux vraies réalités. Le temps est pourri, et nos jardins envahis. Comment se débarrasser de cette nuisance, et enfin pouvoir nous consacrer à la vraie vie, la lecture ?
Le centenaire de l’illustre anthropologue français Claude Lévi-Strauss n’aura pas échappé à la redoutable machine à célébrer qu’est devenue l’édition. Rien d’étonnant à cela, le monde éditorial, comme la presse écrite et audiovisuelle, ayant un besoin constant de matière pour alimenter la production. On n’imagine pas d’ailleurs l’angoisse qui doit toucher les éditeurs lorsque cette matière leur manque. Ce n’est plus l’angoisse de la page blanche, comme pour l’écrivain, c’est l’angoisse de l’absence sur les tables des libraires. Nul n’y échappe, pas même nous, puisque nous voici en train d’en parler.

